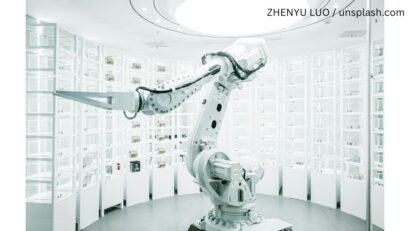La culture de sécurité, un bouclier nécessaire
Grâce à son appartenance à l'OTAN et à l'Union européenne, la Roumanie bénéficie de garanties solides, mais la perception publique est parfois marquée par un sentiment d'insécurité. Peut-être aussi parce que nos esprits sont également un champ de bataille, en proie à des messages qui amplifient les craintes, cultivent la méfiance envers les institutions et exploitent les fractures sociales. L'insécurité devient ainsi un instrument stratégique.

Corina Cristea, 10.10.2025, 11:08
De nos jours, la sécurité est un des principaux sujets d’actualité, non seulement dans le sens militaire, mais dans un sens beaucoup plus vaste. Il suffit de prendre en considération les guerres des dernières années pour comprendre que les conflits modernes ne se font plus uniquement avec des chars et des avions. La guerre en Ukraine, à la frontière roumaine, a des effets qui dépassent largement le champ de bataille. Il s’agit d’une guerre hybride, qui ajoute aux méthodes traditionnelles des tactiques censées déformer les perceptions, la confiance et la façon de voir le monde. Ce qui se passe actuellement est bien plus grave qu’une guerre hybride, explique le professeur Iulian Chifu, analyste en politique étrangère et sécurité. Il fait une radiographie de la situation actuelle :
« Ce qu’il faut noter c’est l’ampleur des menaces actuelles, leur diversité, en plus de l’apparition de plusieurs foyers d’instabilité et de crise, voire de guerre. Tout ce contexte sécuritaire problématique entraîne des changements fondamentaux. Dans notre histoire moderne, d’il y a un siècle, nous assistions d’abord à des confrontations armées, puis à des tensions étatiques, qui opposaient les institutions et les ressources de certains pays et ensuite à des guerres hybrides. Mais de nos jours nous sommes arrivés à mener une guerre totale, sur un éventail bien plus complet, qui utilise toute sorte d’instruments aussi bien militaires que civils, très bien orchestrés, afin de produire des effets négatifs et de porter atteinte à des objectifs militaires et sécuritaires, pour fragiliser le niveau de sécurité. Nous devons nous préparer à vivre dans ce monde de demain, en proie à des menaces que les États et leurs institutions ne pourront plus combattre seuls. Ils auront besoin du soutien des sociétés civiles, des ONG, des entreprises privées et des citoyens. Il faut donc cumuler tous nos efforts pour protéger nos sociétés des menaces hybrides et de l’infoguerre ».
L’éducation à la sécurité, une approche suffisante ?
Grâce à son appartenance à l’OTAN et à l’Union européenne, la Roumanie bénéficie de garanties solides, mais la perception publique est parfois marquée par un sentiment d’insécurité. Peut-être aussi parce que nos esprits sont également un champ de bataille, en proie à des messages qui amplifient les craintes, cultivent la méfiance envers les institutions et exploitent les fractures sociales. L’insécurité devient ainsi un instrument stratégique. Il existe plusieurs types d’insécurité, en dehors de celle militaire, évidente dans le cas d’un conflit armé. Nous parlons d’insécurité économique lorsque, par exemple, les prix explosent sous la pression d’une guerre à la frontière, d’insécurité sociale lorsque la méfiance envers les autres augmente, mais aussi d’insécurité informationnelle lorsque l’on ne sait plus démêler le vrai du faux. Il en résulte un sentiment de vulnérabilité qui peut avoir un impact sur toute une société, en provoquant des tensions sociales et des blocages économiques. En bref, la guerre cognitive est une arme subtile, mais qui peut s’avérer très efficace. Face à ces défis, la stratégie de défense ne se limite plus aux troupes militaires et aux armes, mais implique une réponse coordonnée de la part de toute la société. Cela relève d’une culture de sécurité, qui renvoie au degré de sensibilisation de chacun d’entre nous aux questions de sécurité, à la prévention des conflits et à la promotion des mesures nécessaires pour protéger l’Etat. Il s’agit donc d’un engagement actif et conscient aussi bien individuel que collectif. Et cette culture se construit par l’éducation. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Prenons l’exemple de la Norvège qui, grâce à des investissements dans la préparation civile et militaire de la population et à une collaboration étroite entre la société civile et les autorités, a réussi à renforcer sa sécurité nationale et à s’adapter aux menaces régionales, y compris russes.
L’analyste Iulian Chifu poursuit :
« L’éducation reste très importante et de nos jours, les enfants apprennent à l’école certaines notions liées à la guerre cognitive, à la désinformation, aux fake news. Bien sûr, cela ne suffit pas, car l’agresseur invente d’autres instruments de manipulation. Quand il s’agit de la Fédération de Russie, il n’y a pas de limites morales ou démocratiques. Eh bien, nous devons nous préparer à contrecarrer cette guerre, tout en utilisant nos outils démocratiques. Et cela se fait difficilement, dans le temps, par l’intermédiaire de l’éducation, d’une communication stratégique et d’un climat de confiance entre les décideurs, les dirigeants, les responsables politiques, les dirigeants de différentes structures institutionnelles et les populations. »
Une confiance qui, force est de le constater, s’étiole chaque jour un peu plus, et une éducation qui peine à être à la hauteur de la tâche, surtout par manque de moyens. Ce n’est pas simple, surtout en pleine période de crise, ajoute Iulian Chifu, mais nous devons nous mobiliser tous pour protéger la sécurité de notre monde.