
Ecoutez le podcast international «Monuments méditerranéens entre ciel et mer».

L'essentiel de l'actualité roumaine, en français, en 56 minutes.
Cela fait plus de trois ans que la Roumanie accueille un des groupes de combat de l’OTAN déployés par l’Alliance de l’Atlantique Nord afin de renforcer son flanc oriental. Nous faisons aujourd’hui la connaissance de militaires de plusieurs pays qui ont fait partie de cette structure.

Le gouvernement de Bucarest doit annoncer la forme finale du paquet de mesures fiscales visant à réduire le déficit budgétaire/Une nouvelle attaque aux drones a eu lieu près de la frontière roumaine dans la nuit de mardi à mercredi et deux avions F16 des forces aériennes roumaines ont décollé pour suivre la situation.
Un été sous pression s’annonce pour l’économie et la société roumaines.

La Roumanie préserve son engagement ferme de moderniser son armée, en étroite coopération avec les Etats-Unis, a déclaré le ministre roumain de la Défense/ Bucarest plaide en faveur de la poursuite de l’élargissement européen dans les années à venir/ La Roumanie a éliminé à partir du 1er juillet, le tarif plafonné du kWh d'électricité.

L’évasion fiscale demeure une vulnérabilité majeure pour la Roumanie – ont décidé les membres du Conseil suprême de défense de la Roumanie/La Roumanie renonce aujourd’hui au plafonnement du prix de l’électricité et les spécialistes s’attendent à une flambée des factures que devront payer les Roumains/Tous les contrôles à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie ont été éliminés dans la nuit de lundi à mardi, suite à l’adhésion des deux Etats à l’espace Schengen de libre circulation européenne.

Convoqué pour la première par le nouveau président roumain, Nicușor Dan, le Conseil suprême de la défense de la Roumanie s'est réuni lundi à Bucarest

L'évasion fiscale, l'inondation de la mine de sel de Praid, ainsi que la guerre illégale et non provoquée déclenchée par la Russie contre l’Ukraine ont figuré à l’ordre du jour de la réunion du Conseil suprême de la défense de la Roumanie, convoquée ce lundi par le président Nicuşor Dan/ Le Gouvernement roumain a adopté ce lundi un décret d’urgence visant à supprimer des bonus offerts aux employés du secteur public, une mesure parmi celles censées réduire le déficit budgétaire./ Tombée de rideau, dimanche, sur l’édition 2025 du Festival international du théâtre de Sibiu, en Transylvanie.

Le président Nicuşor Dan a convoqué ce lundi une réunion du Conseil suprême de la défense de la Roumanie/Le gouvernement de Bucarest présentera cette semaine un paquet de mesures visant à réduire le déficit budgétaire et à améliorer l’accès aux fonds européens/Tombée de rideau dimanche de l’édition 2025 du Festival international du théâtre de Sibiu, dans le centre.

Tombée de rideau sur une nouvelle édition du Festival international de théâtre de Sibiu (FITS), un évènement majeur des arts du spectacle de Roumanie. 10 jours durant environ 850 évènements ont eu lieu à Sibiu dans le cadre du festival qui a accueilli 5000 artistes venus de plus de 80 pays

Un nouveau Cabinet à Bucarest / Les priorités de l’Exécutif roumain / Le président roumain a participé aux sommets de La Haye et de Bruxelles / Des nominations de haut niveau / La canicule s’empare de la Roumanie

Les mesures de réduction du déficit budgétaire impliqueront des couts sociaux, mais elles sont inévitables pour assurer un Etat efficace, qui ne gaspille pas ses ressources, a déclaré le premier ministre roumain Ilie Bolojan/Le Conseil national du Parti national libéral s’est réuni aujourd’hui au Palais du Parlement pour convoquer le Congrès du PNL et pour approuver le projet de statut du parti, qui est membre de la coalition gouvernementale à Bucarest.
Convertisseur de devise RON/EUR: mer, 2 Juil.

Ce document, s’appuie sur une logique innovante : à travers une série de questions pertinentes (Q), le système éducatif et scientifique roumain peut être préparé à affronter l’inconnu (X) de demain. Le rapport propose un cadre réformateur fondé sur trois piliers : les données factuelles, les meilleures pratiques européennes et internationales, et les analyses critiques du ministre de l'Education lui-même.
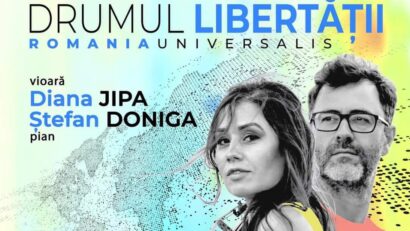
Célébrant les 35 ans de la Révolution anticommuniste roumaine de décembre 1989, la violoniste Diana Jipa et le pianiste Ştefan Doniga ont réalisé une tournée appelée « Le chemin de la liberté ». Considérée déjà comme l’une des plus amples promotions de la culture roumaine dans le monde, leur initiative a décroché le Record mondial de la tournée la plus rapide sur tous les continents.

Une clause qui a permis à la Roumanie de bénéficier de conditions commerciales plus avantageuses de la part des Etats-Unis.

L’archéologie étudie le passé de la société humaine en récupérant et analysant la culture matérielle et les informations fournies par les artefacts, les documents, l’architecture ou les paysages culturels découverts. Autrement dit, elle cherche à déchiffrer le mode de vie, les croyances et les coutumes des temps passés, en étudiant les traces disponibles de nos jours.

La Galerie « La cellule d’art » du centre de Bucarest accueille du 17 mai au 16 juin 2025 l’exposition « Dans la cuisine. Des gâteaux faits maison » des artistes Ana-Cristina Irian et Cristian Bassa. Ils ont imaginé une exposition qui se concentre sur l’importance de la table de cuisine, cet endroit qui réunit toute la famille. Mémoire de famille.

Du 10 juin au 15 juillet 2025 aura lieu la deuxième phase du Recensement International des cigognes blanches en Roumanie. Cette initiative est coordonnée par la Société Ornithologique roumaine, dans le cadre d’une démarche européenne qui a lieu tous les dix ans. Si les bénévoles ont recensé plus de 3.300 nids en 2024, la phase actuelle vise à compléter les données de terrain.

Le tuspeis est un plat de la région de Banat, dans le sud-ouest de la Roumanie, une région multiethnique et multiculturelle, qui s’enorgueillit aussi d’un énorme patrimoine culinaire.
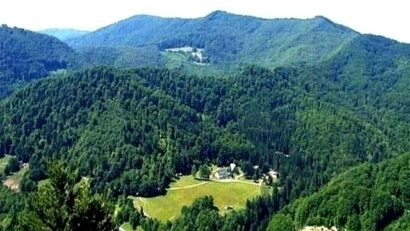
Au cœur des Carpates orientales, à la frontière des départements de Covasna et Harghita, s’étendent plusieurs stations thermales qui exploitent les vertus thérapeutiques des eaux minérales locales. Parmi elles, Băile Tușnad, surnommée la « perle des Carpates », se distingue par sa situation pittoresque à 66 kilomètres au nord de Brașov.

L’acclimatation des plantes tropicales en Roumanie n’est plus une utopie agricole, mais un chantier en pleine expansion. Il s’agit d’un processus exigeant, nécessitant l’adaptation d’espèces originaires de zones chaudes et humides à un climat tempéré, parfois capricieux. Si l’entreprise reste complexe, elle devient néanmoins viable dans certaines régions bénéficiant de microclimats spécifiques — comme la Dobrogea, dans le sud-est du pays — ou dans des espaces protégés, tels que les serres ou les solariums.

Sise dans le département de Gorj, la commune de Polovragi invite à la détente et à la découverte.

La 6e édition de la Biennale d'art contemporain Art Encounters, qui se tient jusqu'au 13 juillet à Timisoara, dans l'ouest de la Roumanie, propose un dialogue entre le passé et le présent, entre l'histoire et l'art contemporain. Bernard Blistène, ancien directeur du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou-Paris revient sur l'impact de la Biennale, sur l'exposition qu'il a consacrée à l'artiste roumain Ștefan Bertalan et sur l'art roumain exposé au fil du temps à Paris.

Paru chez Gallimard, le roman a remporté le Prix des cinq continents de la Francophonie en 2025.

Voici les principales tendances des Roumains en matière de voyages, dont notamment les modalités de paiement préférées des touristes roumains lorsqu’ils voyagent à l’étranger.
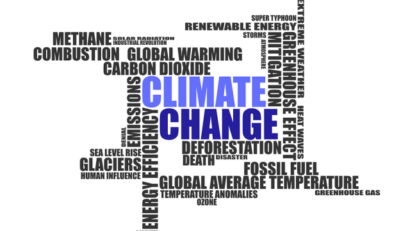
La désinformation sur les changements climatiquesest un obstacle majeur pour l'adoption de politiques efficaces de protection de l'environnement et pour la transition vers une économie durable. Malgré le consensus scientifique sur l'impact des activités humaines sur le climat, de nombreuses fausses théories continuent de circuler dans l'espace public, influençant les perceptions et les comportements des citoyens.

L'essentiel de l'actualité roumaine, en français, en 56 minutes.

L'essentiel de l'actualité roumaine en 56 minutes.

L'essentiel de l'actualité roumaine en 56 minutes.

Voici les horaires et fréquences de RRI, valables du 30 mars au 25 octobre 2025.

Le thème de cette année : "Radio et changement climatique". Rendez-vous ce jeudi, 13 février, sur les ondes de RRI, pour une édition de notre RRI Spécial consacrée à la Journée mondiale de la Radio.

L’émetteur BD 300-2 de Tiganesti est de nouveau fonctionnel

Lecţia şaptezeci Dominique : Bună ziua. Ioana : Bună dimineaţa. Andrei : Bună seara. Valentina : Bună....

Lecţia şaizeci şi nouă Dominique : Bună ziua. Ioana : Bună dimineaţa. Andrei : Bună seara. Valentina :...

Nostru, noastră
